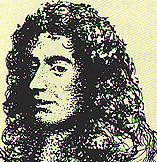Jean
Dominique Cassini, dit Cassini Ier
Jean
Dominique Cassini, dit Cassini Ier(Perinaldo, 1625 - Paris, 1712)
Premier d'une lignée d'astronomes qui dirigèrent l'Observatoire de Paris durant plus d'un siècle, il commençe sa carrière d'astronome au service d'un riche amateur de Modène, le marquis C. Malvasia. Ses observations et ses publications lui valent d'être nommé professeur d'astronomie à l'université de Bologne en 1650. En 1663, il entre au service du pape. En 1668, Colbert lui propose d'être membre de la nouvelle Académie. Cassini ayant accepté, Colbert l'invite à venir en France afin de participer à la construction de l'Observatoire de Paris. Il arrive à Paris le 4 août 1669 et collabore aussitôt aux travaux de l'Académie, modifiant les plans de l'architecte Perrault pour adapter le bâtiment aux observations astronomiques. Dès 1671, avant même que l'Observatoire ne soit achevé, il commençe ses travaux d'observation et de recherche. Malgré les rappels du pape, il manifeste le désir de rester en France et sollicite une naturalisation qu'il obtient en 1673. Devenu aveugle en 1710, il meurt le 17 septembre 1712 à l'âge de 87 ans. On doit à cet observateur assidu et méticuleux la découverte de quatre satellites de Saturne, ainsi que celle d'une rupture dans l'anneau de cette planète, dite division de Cassini; il a de plus établi une excellente carte de la surface lunaire. Pour plus de détail un site à visiter l'Observatoire de Nice.